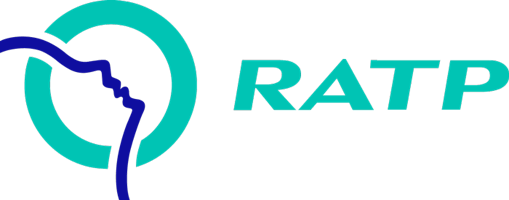Consultez la nouvelle lettre d'information du projet de prolongement du Tram T7 !
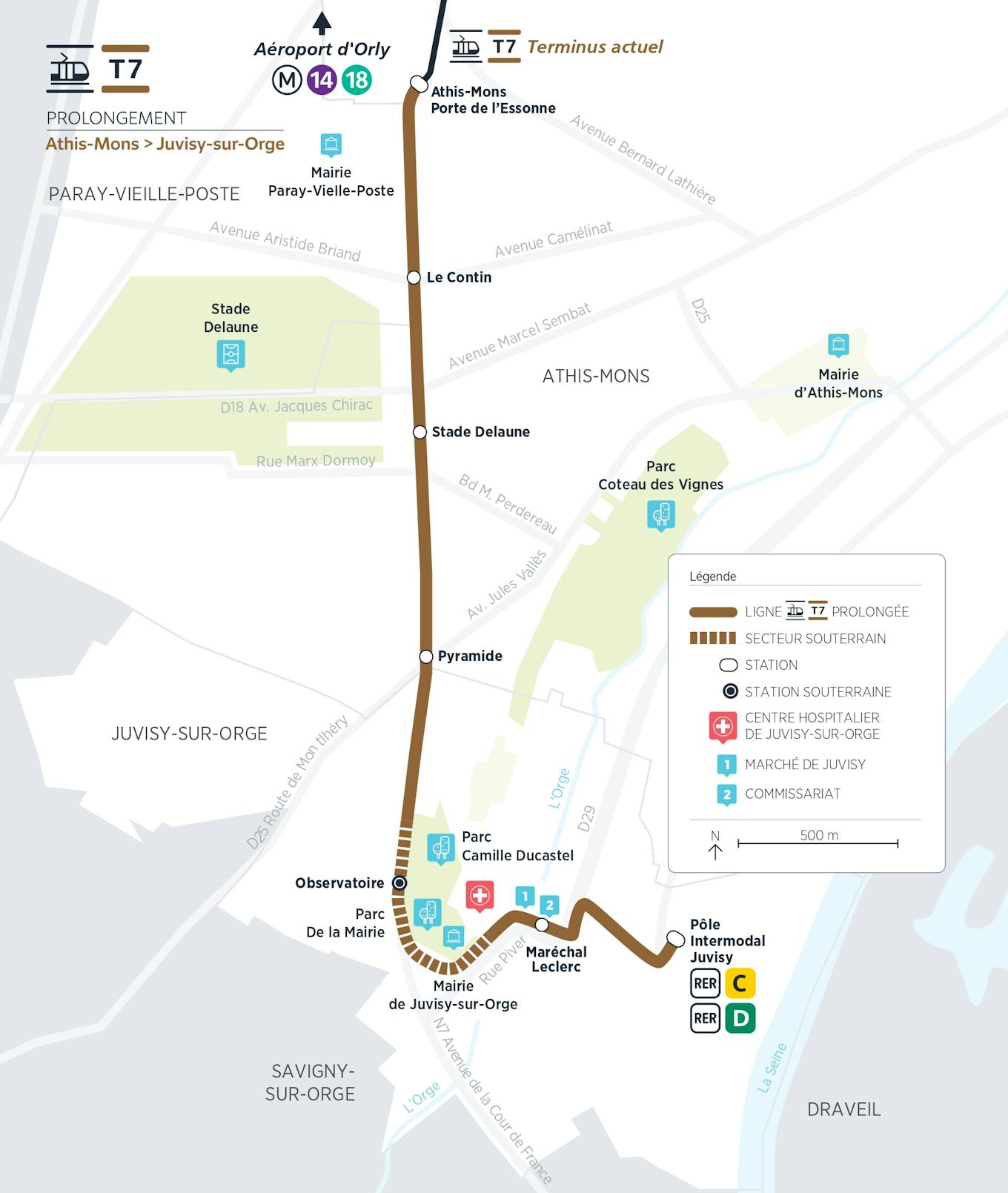
Plan du prolongement du Tram T7 de Athis-Mons à Juvisy-sur-Orge.
- 2008 : Concertation
- 2008-2011 : Études préliminaires
- 2012 : Schéma de principe
- 2013 : Enquête publique / Déclaration d’utilité publique
- 2013-2017 : études de tracé alternatifs
- 2017-2019 : Études d’avant-projet
- 2020 : Poursuite des études de conception détaillées / Finalisation des études concessionnaires / Élaboration des dossiers réglementaires (sécurité, autorisation environnementale, permis d’aménager)
- 2021 : Restitution des études travaux
- 2022 : Dossier d’autorisation unique et dossier préliminaire de sécurité / Passation des 1er marchés travaux / Démarrage des travaux concessionnaires (2e semestre)
- 2023 : poursuite des travaux préparatoires
Le financement
- L'infrastructure : 223,5 millions d'euros, valeur 2011
- Les trams : 29 millions d’euros, valeur 2018 (Île-de-France Mobilités)
- L'exploitation (Île-de-France Mobilités)
Les acteurs
Les maîtres d’ouvrage du projet sont :
- Île-de-France Mobilités (infrastructures)
- la RATP (extension du site de maintenance et adaptation du poste de commandement local)